Dream Theater - Dream Theater
Sorti le: 13/10/2013
Par Guillaume Meyer
Label: Roadrunner Records
Site: http://dreamtheater.net
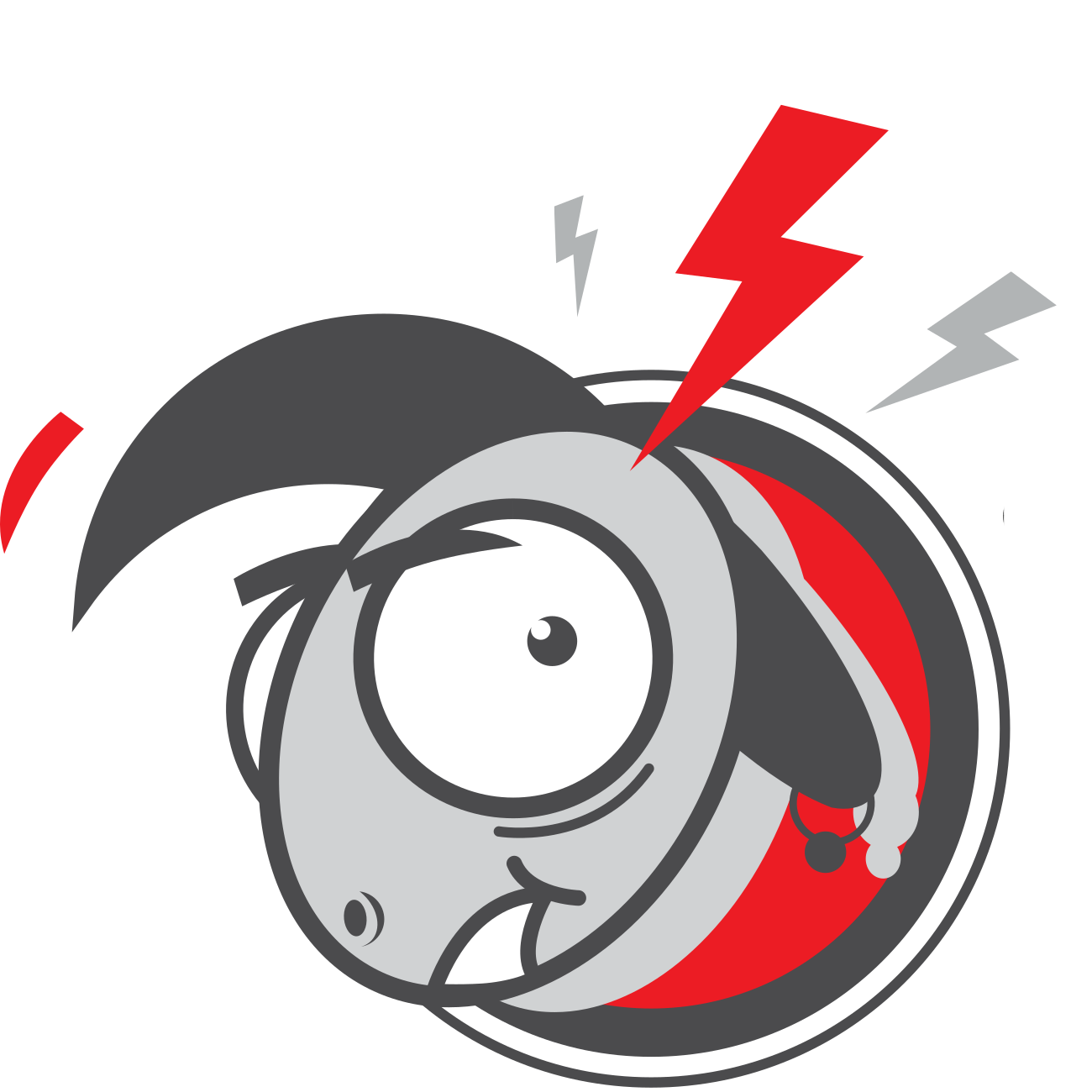
Face à une nouvelle livraison des architectes du genre metal progressif outre-Atlantique, décevante comme l’on pouvait s’y attendre, il s’agit de ne pas perdre ses nerfs et ne pas crier d’emblée à l’enfumage commercial… même si la tentation est grande. Pour éviter cet écueil, une méthode simple et fiable : baisser ses attentes, jusqu’à un niveau qui rend l’écoute de ce nouvel album acceptable. Il reste ainsi à admettre le postulat que tout ce qu’a fait Dream Theater depuis Six Degrees Of Inner Turbulence souffre à la fois d’une douloureuse baisse de la qualité d’écriture et de la production, mais également de la triste particularité de ne pas être pour autant parvenu à rendre cette chute qualitative agréable à l’écoute, en la transformant en simplification de bon goût par exemple. À cette condition, il devient possible de considérer ce nouvel album au titre éponyme presque comme réussi.
Réussi, bien sûr, dans le sens où il ne dépare pas de ses prédécesseurs : on y déniche comme toujours quelques riffs intéressants, des solos de guitare démontrant l’exceptionnelle dextérité de leur exécutant, à défaut de son talent mélodique, et enfin des atmosphères plutôt réussies, puisant leur inspiration à différentes sources thématiques et temporelles, le tout au sein de morceaux dont l’écoute est, somme toute, agréable. Mais, dans un souci de rigueur, il paraît impossible de ne pas signaler que de nombreux tics mélodiques, de production, de chant, sont odieusement volés à d’autres, voir à des albums précédents, au mépris de tout critère de qualité. « False Awakening Suite » n’est ainsi qu’une resucée ratée de l’« Overture » de Six Degrees…. « The Looking Glass », exemple le plus pertinent sans doute, est un mélange étonnant de n’importe quel morceau de Rush et d’un extrait d’Images & Words choisi au hasard. « Enigma Machine » semble être une chute de studio, abandonnée lors des séances de travail d’Awake. Quant à la courageuse tentative d’insérer au milieu de la longue pièce « Illumination Theory » un intermède de musique classique, bien trop violoneux au demeurant, il s’avère rapidement qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’un collage de mélodies issues de Rhapsody In Blue et du premier concerto pour piano de Tchaikovsky. Enfin, pour couronner l’ensemble, de toute évidence, James LaBrie n’a pas su se débarrasser de cette pénible propension à proposer des lignes mélodiques de plus en plus bas de gamme (preuve en est son récent effort solo, dont la nullité crasse ferait passer ses rares réussites sur ce Dream Theater pour des chefs d’œuvre dignes d’un Brian Wilson).
Difficile de déterminer si les membres du groupe ont décidé de prendre leurs fans pour des guignols, ou si on assiste simplement à la lente disparition d’un grand nom autrefois réputé pour la qualité de ses œuvres, aujourd’hui devenu un ersatz nostalgique de ce qu’il fût dans les années 90. Sans doute un peu des deux. On ne saurait que trop conseiller à Dream Theater d’arrêter de proposer à son public un album médiocre tous les deux ans, ceux-ci ayant une nette tendance à ne plus savoir les différencier. En effet, il semble impossible de dégager de cet opus une différence notable, une volonté, un projet, autant qu’il l’était de A Dramatic Turn Of Events, Black Clouds & Silver Linings et Systematic Chaos. Ces quatre albums se ressemblent d’une manière qui, déroutante en 2009, est aujourd’hui devenue proprement ennuyeuse. Tout espoir n’est pas perdu, et un léger mieux reste envisageable, mais il faudrait pour cela une sélection plus rigoureuse des morceaux, et une véritable pause entre deux saisons de travail et de tournée, dans le but de recharger les batteries créatives des membres du groupe. Enfin, une dernière condition, mais pas des moindres, semble vitale pour le groupe : l’embauche d’un producteur, qui pourrait se permettre de dire à Petrucci de cesser de se prendre pour Neal Morse, de réformer la bouillie sonore qu’est devenu Dream Theater et signifier à LaBrie que non, il ne peut pas se permettre un énième couplet larmoyant sur les accords de piano cucul-la-praline de Jordan Rudess. Pourquoi ? Mais parce que c’est mauvais, James, très mauvais !